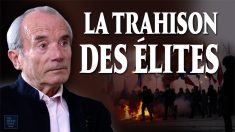La ligne de radar avancée d’alerte (DEW Line) s’étend au nord du cercle arctique, de l’Alaska à l’ouest jusqu’à l’île de Baffin à l’est, avant de se prolonger à travers le Groenland. Elle a été construite par les États-Unis, avec la coopération du Canada, au plus fort de la Guerre froide dans les années 1950, afin de se défendre contre l’Union soviétique.
La plupart des bases autonomes de cette ligne disposaient d’une piste d’atterrissage goudronnée et étaient équipées du matériel et du personnel nécessaires pour en assurer le déneigement. Ces bases devaient rester pleinement opérationnelles pour accueillir les dizaines d’avions de chasse maintenus en alerte par le Strategic Air Command des États-Unis, prêts à intervenir en cas d’incursion d’avions soviétiques par le pôle Nord.
La plupart de ces sites ont progressivement cessé d’être utilisés, et la DEW Line a cédé la place au North Warning System. Depuis, peu d’évolutions notables ont eu lieu. Bien que le gouvernement Canadien ait promis d’entretenir le site, aucune mesure concrète n’a été prise par Ottawa pour renforcer efficacement la protection de ce territoire. De même, bien que le gouvernement ait promis de moderniser ses engagements au sein du NORAD (North American Aerospace Defense Command), cette question a été largement négligée.
L’administration de Donald Trump a clairement exprimé son insatisfaction quant à l’état de préparation défensive du Canada. Cette critique est fondée.
La réalité du monde d’aujourd’hui est bien différente de celle des années 1950 et 1960. À cette époque, l’Union soviétique représentait la principale menace pour l’Occident, tandis que la Chine communiste était extrêmement pauvre et fragile. Sous l’égide de Mao Zedong, les politiques du « Grand Bond en avant » et de la « Révolution culturelle » ont entraîné des famines qui ont coûté la vie à des millions de personnes. La Chine ressemblait alors bien plus à la Corée du Nord qu’au géant économique et militaire qu’elle est devenue aujourd’hui. Elle ne constituait en aucun cas une menace.
Désormais, la Chine communiste et une Russie de plus en plus agressive sont deux adversaires redoutables, tous deux très intéressés par l’Arctique. De manière inquiétante, ils ont récemment scellé un partenariat qualifié d’ « amitié sans limites », soulevant la possibilité qu’ils pourraient collaborer (ou collaborent déjà) à des plans conjoints d’exploitation militaire et commerciale du Nord.
L’une des raisons majeures de cet intérêt est la perspective d’une navigation à grande échelle par le passage du Nord-Ouest, qui pourrait devenir une réalité dans un avenir proche. Ce passage permettrait de réduire considérablement les distances maritimes, générant ainsi des économies conséquentes en termes de temps, d’argent et de carburant. Une route maritime entre l’Asie et l’Europe via le passage du Nord-Est (aussi appelé Route maritime du Nord) et le passage du Nord-Ouest représenterait une valeur stratégique, militaire et commerciale inestimable pour la Russie et la Chine.
La Russie a une avance considérable sur le Canada en matière de stratégie et de développement dans le Nord. Elle possède au moins 40 navires capables de briser la glace, dont huit brise-glaces à propulsion nucléaire. Le Canada, quant à lui, ne dispose d’aucun brise-glace à propulsion nucléaire. Les promesses récentes de construire deux de ces navires ne verront pas de résultat avant plusieurs années. Les États-Unis sont pleinement conscients de la supériorité russe dans cette région.
La sécurité du Nord explique en partie la proposition très médiatisée de Donald Trump d’acheter le Groenland. Lui seul ainsi que ses conseillers les plus proches, savent s’il était sérieux à ce sujet, ou s’il cherchait simplement à obtenir de meilleures garanties d’accès.
Le Pentagone doit nécessairement s’inquiéter à l’idée que le Groenland puisse tomber sous le contrôle de ses adversaires, voire de futurs ennemis. Une telle hypothèse est-elle si lointaine ? Le Groenland compte seulement 56.000 habitants. La Chine et la Russie pourraient facilement, de façon conjointe ou non, rendre chaque Groenlandais millionnaire avec la modique somme de 56 milliards de dollars, une goutte d’eau pour ces puissances. L’Amérique ne devrait-elle pas prendre les devants en proposant une offre avant les autres?
Plutôt que d’acheter directement l’île, la Chine pourrait aussi y prendre pied grâce à des entreprises sous contrôle du Parti communiste, comme elle l’a fait ailleurs avec son initiative « la Ceinture et la Route ». Ce n’est plus l’époque des empires européens distribuant des colifichets à des populations indigènes, mais celle d’hommes d’affaires chinois habiles, utilisant des stratégies similaires.
Or, une simple consultation de la carte suffit pour voir à quel point le Groenland est proche du Canada. Donald Trump partage probablement les mêmes inquiétudes quant à l’Arctique canadien, d’autant plus que certaines décisions récentes du Canada ne peuvent qu’alarmer Washington.
Un élément d’inquiétude supplémentaire est la cession partielle de souveraineté du Canada au Nunavut. Comme le Groenland, le Nunavut est immense, riche en ressources naturelles, stratégiquement essentiel, et peu peuplé.
Nous savons combien les États-Unis surveillent la présence chinoise au canal de Panama. Pourquoi en irait-il autrement du passage du Nord-Ouest ? Ne devrions-nous pas nous inquiéter du fait que la Chine a déjà commencé, discrètement, à conclure d’importants accords avec des territoires autochtones semi-autonomes ?
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.