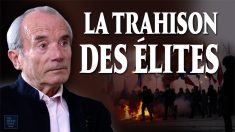Ce matin, lors d’un entretien, un homme m’a demandé quelles seraient, selon moi, les formes dominantes d’organisation sociale et politique dans les années à venir, à la lumière de l’échec des orthodoxies dominantes de ces dernières années.
Je me suis trouvé quelque peu pris au dépourvu pour formuler une réponse, mais la question m’a intrigué. Elle repose sur l’hypothèse que nous vivons une période de bouleversements majeurs, une transition d’un paradigme à un autre. Cela est indéniablement vrai. La perte de confiance du public envers presque toutes les institutions est plus qu’évidente.
Le changement est déjà en cours et ne fait peut-être que commencer. Si l’équipe du président Trump prend réellement au sérieux son projet d’assainissement du secteur public américain, d’autres bouleversements majeurs sont à prévoir. Ce que nous considérions comme acquis sera remis en question. L’opinion publique doit se préparer à des années d’étonnement permanent face à l’usage qui a été fait de ses impôts.
Où allons-nous ?
Pour revenir à la question de notre avenir, ma première réponse instinctive serait que nous nous dirigeons vers une forme de société et de culture similaire à celle que nous connaissions avant la Première Guerre mondiale : des communautés à échelle humaine, des familles intactes, une culture dynamique fondée sur la foi et la créativité, et un lien étroit entre le peuple et ses dirigeants, sans l’épaisse couche bureaucratique qui nous en sépare aujourd’hui.
Ces interrogations profondes m’ont conduit à me replonger dans un ouvrage que je possède depuis longtemps sans jamais l’avoir lu : The Managerial Revolution de James Burnham (L’Ère des organisateurs, en français). Ce livre, écrit en 1940, alors que les États-Unis s’apprêtaient à entrer en guerre contre l’Europe et le Japon, fut publié en 1941, à une époque où beaucoup se demandaient quel type de société ils étaient en train de façonner. Le monde avait déjà traversé une guerre dévastatrice, subi une longue dépression économique, et se trouvait à l’aube d’un nouveau conflit accompagné d’un inévitable renforcement du contrôle étatique.
Burnham était une figure sombre, que certains qualifiaient de réaliste et d’autres, de cynique. Il considérait la politique comme une lutte perpétuelle pour la conquête et la conservation du pouvoir, rien de plus. À ses yeux, les idéaux de chaque époque n’étaient que des discours creux masquant des luttes d’influence. Il ne portait aucun jugement moral sur cet état de fait, mais le prenait simplement comme une réalité à laquelle il fallait se confronter.
Ce qu’il observait en 1940 était une consolidation spectaculaire des structures sociales. Il rejetait les notions de « socialisme » et de « capitalisme », les jugeant obsolètes et inadaptées au monde en train de naître. L’époque des paysans indépendants, des propriétaires terriens et des innombrables petits commerces était révolue. À leur place, de grandes entreprises dirigées par une classe managériale avaient émergé, une élite qui, bien que détentrice du pouvoir, ne possédait pas réellement les structures qu’elle administrait. Il en allait de même dans les universités, les médias et les bureaucraties gouvernementales : les gestionnaires professionnels, armés de leurs diplômes et certifications, prenaient les commandes.
Quant au socialisme, Burnham n’y voyait qu’une illusion. Il croyait en une loi de fer de l’oligarchie : un groupe prendrait toujours le contrôle. Toute l’idée d’une société sans classes et d’une propriété collective n’était, selon lui, qu’un rêve idéologique. Prenant l’URSS en exemple, il considérait le langage socialiste comme un simple outil rhétorique, employé par une clique de dirigeants pour s’emparer du pouvoir aux dépens de l’ancien régime.
Une analyse prophétique ?
Le livre de Burnham est une lecture difficile, notamment en raison de l’absence totale d’idéalisme dans son propos. Pourtant, il me semble qu’il décrivait avec justesse la trajectoire du monde en 1940. Après la guerre, un ordre « libéral » s’est établi, suivi par la Guerre froide. Pendant quarante ans, la rhétorique dominante opposait la liberté à la tyrannie. Du point de vue de Burnham, ce n’était pas une description pleinement exacte de la situation.
Après la Guerre froide, nombreux ont été ceux qui, tant à gauche qu’à droite, espéraient récolter les fruits de la paix et retrouver une certaine normalité. Mais les événements n’ont pas suivi ce cours. La classe managériale s’est renforcée. L’État s’est étendu. Le secteur financier a gonflé. La dette a explosé. Les universités et les médias sont devenus de plus en plus dépendants du soutien gouvernemental. Les réseaux de pouvoir se sont ramifiés toujours plus profondément, tant au niveau national qu’international. La vision de Burnham, formulée en 1940, s’était pleinement réalisée.
En parcourant cet ouvrage, je remarque cependant une différence notable entre le monde d’alors et celui d’aujourd’hui : la confiance du public envers l’expertise. Autrefois élevée, elle est aujourd’hui au plus bas. Cela affecte directement la perception des compétences de la classe managériale. Pendant la majeure partie de ma vie, cette élite professionnelle a bénéficié d’un immense prestige politique, social et économique. Chacun aspirait à l’intégrer et à la consolider davantage.
Mais au XXIe siècle, la bureaucratie s’est accrue, tant dans le secteur public que privé. La conformité a supplanté la créativité. La réglementation a freiné l’innovation.
Un changement radical en cours
Cela dit, un vent de changement souffle soudainement, et le tournant semble avoir été l’expérience scientifique à grande échelle imposée au public entre 2020 et 2023, sous prétexte de lutte contre une pandémie. La révolution managériale a pénétré jusqu’à nos foyers, nos communautés, de la manière la plus coercitive qui soit. Elle a fermé les commerces et les écoles, restreint les déplacements, imposé le port du masque et, finalement, forcé la vaccination de populations qui ne la souhaitaient pas. Rien de tout cela n’avait de sens, et les dégâts furent sans précédent.
C’est précisément ce qui a déclenché la révolte contre la classe managériale. La guerre contre le virus n’impliquait pas seulement les gouvernements, mais l’ensemble de la société civile : universités, sciences, grandes entreprises, associations. Un système s’est mis en place, où une classe professionnelle dirigeait un prolétariat relégué à un rôle servile.
La révolte est venue d’en bas – rappelons-nous le mouvement des Gilets jaunes. Les dynamiques politiques sont en plein bouleversement : les classes populaires adhèrent aux nouveaux discours de Donald Trump et les partis souverainistes européens, et la droite voit émerger en son sein des dissidents anti-establishment.
Les conséquences restent à voir, et la nouvelle administration aux États-Unis devra encore batailler pour asseoir son contrôle sur l’exécutif, qui lui résiste à chaque étape. Nous verrons bien, mais il n’est peut-être pas trop tôt pour tenter d’interpréter notre époque. Ce que Burnham appelait la révolution managériale est peut-être en train de s’inverser, redonnant place à une vie normale, privée, et à une conception plus traditionnelle de la liberté.
Si Burnham était encore parmi nous, j’aimerais croire qu’il s’en réjouirait. Mais en réalité, il se contenterait d’observer et de conclure, avec son pragmatisme habituel, qu’un régime en remplace simplement un autre. Peut-être a-t-il raison. Mais j’aimerais croire que ce moment historique est porté par de véritables idéaux.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.