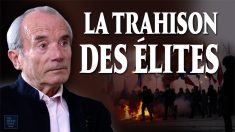L’infertilité est le « tabou du siècle », affirmait en janvier 2024 le président de la République, annonçant « un grand plan de lutte contre ce fléau ». Or, un an plus tard, l’annonce présidentielle n’a guère été suivie d’effets.
« Que l’infertilité soit apparue comme une priorité nationale dans la bouche du chef de l’État, c’était une avancée majeure », mais « on reste au stade déclaratif et à attendre la publication de notre première stratégie sous forme définitive », juge le Pr Samir Hamamah, chef du service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier.
Le Président a parlé d’améliorer l’efficacité de la PMA, alors qu’il faut s’attaquer aux difficultés à concevoir, en réalité liées à des tentatives trop tardives. Pourquoi alors ne pas faire des campagnes d’information sur la baisse de la fécondité après 25 ans ?
Parce que, les enjeux de natalité, dans leurs ramifications multiples, ont des implications politiques. Comment dire, alors que la France est le pays aux 240.000 avortements par an – un droit à l’IVG inscrit dans la Constitution par Emmanuel Macron, qu’il faut maintenant faire davantage d’enfants ?
Une « politique nataliste » pour la nation est mal vue par les groupes du côté gauche du spectre politique. Emmanuel Macron a en effet été critiqué en liant l’annonce du plan infertilité au souhait d’un « réarmement démographique ». On préfère alors reporter les causes de l’infertilité à la conjoncture économique, à l’écoanxiété, à l’accès au logement ou à l’hôpital, etc.
La natalité au plus bas en France depuis 1946
En 2024, 663.000 bébés ont vu le jour dans le pays, soit 2,2 % de moins que l’année précédente, ce qui correspond au plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946.
Cette tendance à la baisse des naissances s’explique en partie par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans (en âge de procréer) et surtout par la baisse du taux de fécondité (nombre d’enfants par femme) qui s’est établi à 1,68 enfant par femme en 2023, contre 1,79 en 2022.
En 2024, on comptabilisait également 646.000 décès, un nombre en progression de 1,1 %, en raison de « l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité ». Conséquence de ces évolutions : le solde naturel de la population française est à peine positif (+17.000 personnes), alors que la croissance de la population française est surtout tirée par le solde migratoire (estimé à +152.000 personnes).
Le nombre d’avortements en hausse
Au total, 243.623 IVG (interruption volontaire de grossesse) ont été enregistrées en France selon les derniers chiffres de 2023, soit 8600 de plus qu’en 2022, précise une étude réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).
La hausse du nombre d’IVG se poursuit après la nette baisse en 2020 et 2021 en lien avec la pandémie de Covid-19. En 2023, le taux de recours à l’IVG atteint 16,8 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2023, contre 16,4 pour 1000 en 2021 et 15,1 pour 1000 en 2020.
Entre 2022 et 2023, les taux de recours ont augmenté pour toutes les classes d’âge chez les femmes majeures, avec une hausse plus marquée pour les 20-34 ans, où les IVG restent les plus fréquentes, l’âge précisément où la fertilité est la plus haute.
Le nombre de vasectomies également en hausse
Les Français sont de plus en plus nombreux à assumer leur choix définitif de ne plus avoir d’enfants en se faisant stériliser. Une loi de juillet 2001 autorise en France la stérilisation, avec le recours pour les hommes à la vasectomie et pour les femmes à la ligature des trompes.
En février 2024, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié une étude révélant que le nombre de vasectomies en France a été multiplié par 15 entre 2010 et 2021, passant de 1940 vasectomies en 2010 à 30.288 en 2022. Les demandes concernant cette intervention chirurgicale dépassent même le nombre de stérilisations féminines, lesquelles ont été divisées par deux entre 2013 et 2022.
L’ANSM précise que les hommes ayant recours à la vasectomie étaient en moyenne de plus en plus jeunes entre 2010 et 2022 (de 44 à 41 ans en âge moyen), et semblaient correspondre à des profils de niveaux socioéconomiques les plus favorisés.
Ils mentionnent comme raison à leur choix, les annonces du GIEC prévoyant des changements climatiques majeurs d’ici 2050 (ce qu’on appelle l’écoanxiété) ou le fait de choisir de ne pas avoir d’enfants par individualisme.
Où est passé le plan contre l’infertilité ?
Début 2024, Emmanuel Macron annonçait un grand plan contre l’infertilité, mais rien n’a avancé. Le nouveau gouvernement a annoncé vouloir à présent s’emparer simultanément des thématiques de vieillissement et de natalité, de logement, de handicap et d’accès aux soins – au risque de mélanger les genres et de ne rien réussir.
Selon un rapport sur les causes de l’infertilité en France, publié en 2022, l’objectif est de réduire l’ampleur du phénomène d’infertilité touchant plus de 3,3 millions de Français qui veulent faire des enfants de plus en plus tard – un chiffre en constante progression.
Si des programmes de recherches ont été lancés pour améliorer l’efficacité des procréations médicalement assistées (PMA), les causes premières de l’infertilité n’ont fait l’objet d’aucune campagne ou mesure concrète auprès du grand public.
Quelques pistes, inspirées du rapport, sont certes étudiées par la Haute autorité de santé (HAS) : une consultation spécialisée à partir de 29 ans pour les femmes et les hommes, et une autre consultation 100 jours avant qu’un couple se lance dans la conception d’un enfant.
Mais « pour tout le reste, je vous mentirais en disant qu’on a avancé sur quelque chose de concret », admet le professeur Samir Hamamah, spécialiste de la reproduction et co-auteur du rapport
Des ramifications multiples
Pourquoi ne pas mieux informer sur la baisse de la fécondité après 25 ans, alors que les difficultés à concevoir sont souvent liées à des tentatives trop tardives ? « Les Français doivent savoir que leur fertilité chute avec l’âge » affirme Samir Hamamah.
Le sujet n’est pas totalement absent de l’agenda du gouvernement. Lors d’un déplacement le 7 février consacré à l’infertilité à l’hôpital parisien Tenon, la ministre de la Santé Catherine Vautrin a évoqué un « plan démographique 2050 ». La ministre a réitéré son souhait de passer par une approche globale qui prenne à la fois en compte les enjeux de natalité et de vieillissement dans leurs ramifications multiples.
« L’idée, c’est de vraiment prendre tous les sujets », également « le logement », le « handicap », « les sujets d’accès au soin » ou « l’alimentation », a-t-elle énuméré, promettant une « feuille de route » pour les mois à venir.
« Il y aura non seulement des choses autour de l’infertilité mais [aussi] des approches globales », a assuré Catherine Vautrin, admettant par ailleurs que le déploiement du plan n’avait pas été aidé par l’instabilité politique et les changements fréquents de gouvernement depuis un an.
Une approche globale et un mélange des genres
Cette approche globale suscite une grande méfiance de la part de spécialistes et d’associations de patients, qui redoutent un mélange des genres pouvant rendre inaudible la question de l’infertilité.
« Ça va nous mettre des bâtons dans les roues », redoute Virginie Rio, présidente du collectif BAMP qui regroupe des patients de l’assistance médicale à la procréation et des personnes infertiles. « On va mélanger des sujets peut-être liés mais qui ont des enjeux et des objectifs différents », avance-t-elle.
Car lier la démographie avec l’infertilité peut être pris, selon certains experts médicaux, comme une contrainte politique qui pourrait pousser les couples à ne plus vouloir faire d’enfants, selon Virginie Rio.
Le Pr Hamamah défend, quant à lui, la création d’un institut national de fertilité, « à l’image de l’Inca pour le cancer (opérateur de l’État, ndlr), pour mieux servir, et sans dépenser plus, une cause touchant à l’humain, à l’intime, à la famille ». « Le plus tôt sera le mieux pour éviter de perdre davantage de temps », a-t-il lancé, jugeant nécessaire « un feu vert du chef de l’État ».
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.