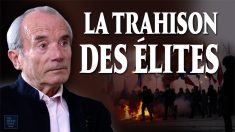Une personne passe en moyenne un tiers de sa vie à dormir. Pendant ce temps, notre esprit imagine des mondes entiers, certains brillants et inoubliables, d’autres disparaissant au moment où nous nous réveillons. Et si on pouvait tirer le meilleur parti de ces heures perdues en se souvenant davantage des rêves ?
Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par les raisons pour lesquelles certaines personnes se souviennent de leurs rêves dans les moindres détails, alors que d’autres peinent à se souvenir de quoi que ce soit. De nouvelles recherches sur les raisons qui nous poussent à rêver, sur les personnes qui se souviennent le mieux de leurs rêves et sur les moyens d’améliorer la mémoire des rêves démystifient peu à peu ce phénomène insaisissable.
Les rêves à travers l’histoire
L’humanité est captivée par la signification des rêves depuis des milliers d’années. Par exemple, dans la culture chinoise ancienne, les rêves étaient considérés comme des messages du monde spirituel, donnant des indications sur l’avenir.
Dans l’Égypte ancienne, les prêtres conservaient des livres de rêves en papyrus dans lesquels ils spéculaient sur les interprétations symboliques des rêves.
La tradition de l’analyse des rêves a ensuite évolué vers une recherche plus structurée. En 1893, Mary Calkins, philosophe et psychologue américaine, a mené une expérience au cours de laquelle elle a réveillé des personnes à la lueur d’une bougie chaque nuit pendant six à huit semaines pour leur demander si elles étaient en train de rêver.
« Parfois, le simple fait d’attraper un papier et un crayon ou d’allumer sa bougie semble dissiper le souvenir du rêve, et l’on se retrouve avec la conscience frustrante d’avoir vécu une expérience onirique intéressante dont on n’a pas le moindre souvenir », a écrit Mary Calkins dans son rapport.
Au milieu du 20e siècle, la recherche sur les rêves est devenue une discipline neuroscientifique officielle. La découverte du sommeil à mouvements oculaires rapides (REM pour Rapid Eye Movement en anglais, MOR en français), en 1953, a suggéré que les souvenirs de rêves les plus vifs se produisaient lorsque les participants étaient réveillés du sommeil REM. Bien que cette découverte ait suggéré que le rêve était l’apanage du sommeil paradoxal, les recherches ont depuis montré que le rêve se produit à de nombreux stades du sommeil, et plus particulièrement chez certains groupes de personnes.
Pourquoi rêvons-nous ?
Selon Jing Zhang, chercheur à la Harvard Medical School et au Massachusetts General Hospital (USA), les rêves sont essentiels au traitement des émotions. Ses récentes recherches, publiées dans Nature Scientific Reports, montrent que les rêves s’apparentent à une « thérapie de nuit ».
Dans cette étude, Jing Zhang et ses collègues ont demandé aux participants de visualiser des images émotionnellement perturbantes, comme des scènes de violence ou de catastrophe, à côté d’images neutres, comme des objets de la vie quotidienne. Le lendemain, les participants qui se souvenaient de leurs rêves présentaient un schéma particulier : ils gardaient un souvenir plus fort des images émotionnellement perturbantes, mais montraient moins de détresse émotionnelle lorsqu’ils les revoyaient. En revanche, leurs souvenirs d’images neutres, émotionnellement insignifiantes, s’étaient estompés.
Cette rétention sélective suggère que le rêve aide le cerveau à hiérarchiser et à traiter les expériences émotionnellement significatives. Selon Jing Zhang, sans rêves, les gens pourraient rester « coincés dans des événements émotionnels », incapables de dépasser des expériences difficiles.
Cependant, tout le monde ne pense pas que les rêves constituent un mécanisme de guérison psychologique. Katja Valli, docteure en psychologie et professeure agrégée de neurosciences cognitives à l’université de Skovde (Suède), présente un point de vue opposé.
Elle a expliqué à Epoch Times que si les rêves reflètent le bien-être émotionnel et psychologique des gens, les traumatismes peuvent perturber ce processus, les rêves rejouant sans cesse les expériences traumatisantes, ce qui maintient la mémoire « active et fraîche » au lieu de la guérir.
La recherche de Katja Valli soutient la « théorie de la simulation de la menace », selon laquelle les rêves fonctionnent comme un mécanisme évolutif nous préparant à des dangers potentiels. À l’instar des pilotes qui s’entraînent dans des simulateurs de vol avant de faire face à des situations d’urgence réelles, nos rêves créent des scénarios réalistes qui nous aident à répéter mentalement les menaces. Ces exercices nocturnes peuvent nous permettre d’être mieux préparés lorsque des défis similaires se présentent dans la vie éveillée – notre cerveau effectue essentiellement des exercices d’évacuation sécurisée (comme en cas d’incendie, ndlr) pendant que nous dormons.
Pourquoi certains s’en souviennent-ils ?
Tout le monde rêve chaque nuit, mais tout le monde ne se souvient pas de ses rêves.
Une étude réalisée en 2025 par l’IMT School for Advanced Studies Lucca en Italie suggère que le souvenir des rêves reflète une interaction entre les traits cognitifs, les attitudes personnelles et la dynamique du sommeil.
Les chercheurs ont constaté que plusieurs éléments – des facteurs environnementaux aux caractéristiques individuelles – déterminaient la capacité de se souvenir des rêves.
L’étude a conclu que les participants qui étaient enclins à la rêverie et à l’esprit vagabond et qui avaient une attitude positive à l’égard du rêve avaient plus de chances de se souvenir de leurs rêves.
Katja Valli, qui n’a pas participé à l’étude, commente : « Les traits de personnalité que sont l’ouverture à l’expérience, la créativité et les frontières psychologiques minces […] prédisent un meilleur souvenir des rêves, tandis que le névrosisme est lié à une plus grande fréquence de rappel des cauchemars. »
Les participants les plus jeunes et ceux qui ont dormi légèrement pendant des périodes plus longues avaient des taux de rappel des rêves plus élevés. Les participants plus âgés se réveillaient souvent avec le sentiment d’avoir rêvé, mais perdaient le souvenir du rêve lui-même, un phénomène appelé « rêve blanc ».
Les saisons jouent également un rôle. Les participants se souvenaient de moins de rêves en hiver qu’au printemps et en automne, ce qui, selon les auteurs, pourrait être dû aux fluctuations des cycles de sommeil, à l’exposition à la lumière ou à l’humeur.
Les rêves comme portails vers l’avenir
La civilisation chinoise antique n’était pas la seule à croire que les rêves pouvaient prédire l’avenir.
« Les rêves précognitifs sont un aspect très courant de l’expérience humaine », a déclaré à Epoch Times Eric Wargo, rédacteur scientifique titulaire d’un doctorat en anthropologie de l’université d’Emory (USA). Il note qu’un tiers à la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir fait des rêves précognitifs, et que presque toutes les cultures croient que ces rêves contiennent des vérités.
Il estime que l’accumulation de preuves et de témoignages suffit à justifier un examen sérieux.
Pour Eric Wargo, les preuves les plus convaincantes de la précognition des rêves ne se trouvent pas dans les laboratoires de psychologie, mais dans les recherches émergentes en physique qui explorent la « rétrocausation », le concept selon lequel les événements futurs peuvent influencer le passé. En effet, les récentes percées en informatique quantique, en biologie quantique et en physique quantique pourraient converger vers des mécanismes potentiels permettant d’expliquer comment l’information peut voyager dans le temps.
Les processus quantiques pourraient expliquer comment notre cerveau traite les informations pendant le sommeil. Lorsque nous rêvons pendant le sommeil paradoxal, les neurones se reconnectent tandis que les souvenirs se forment et se consolident. Ce processus dépend des microtubules, de minuscules structures tubulaires situées à l’intérieur des cellules cérébrales qui, selon certains chercheurs, pourraient fonctionner comme des ordinateurs quantiques.
Si les microtubules sont effectivement de minuscules ordinateurs quantiques, note Eric Wargo, ils pourraient envoyer des informations à rebours dans le temps, permettant aux expériences futures de nous influencer subtilement – ce qui se manifeste par des rêves, de la créativité ou des schémas de pensée inconscients.
« Je pense que la précognition est probablement un aspect de la mémoire – la mémoire des choses du futur », a déclaré Eric Wargo. Les rêves encodent de manière mnémonique des « souvenirs du futur » ainsi que des événements récents (passés).
Comment améliorer la mémoire des rêves
D’innombrables études ont montré que la tenue d’un journal des rêves améliore la mémorisation, tout comme la modification consciente de l’attitude à l’égard de la mémorisation des rêves.
En outre, l’armoise est traditionnellement connue pour améliorer de manière fiable les rêves et le souvenir des rêves.
Jing Zhang, Katja Valli et Eric Wargo recommandent une pratique régulière pour améliorer la mémoire des rêves. Après avoir consigné les rêves en détail dans un journal daté, Eric Wargo conseille de relire les enregistrements du matin même et des jours précédents avant d’aller se coucher – une étape cruciale pour une meilleure mémorisation que les gens omettent souvent de franchir. Il encourage à réfléchir aux liens entre les rêves consignés dans le journal et les expériences vécues dans la vie éveillée.
Eric Wargo recommande également de pratiquer quotidiennement la méditation afin de développer la pleine conscience et le muscle de l’attention au lieu de se laisser aller à un monologue interne ou à des distractions. Débrancher les appareils qui dispersent l’attention peut également aider à développer cette concentration, a ajouté Eric Wargo. De même, Jing Zhang conseille de se réveiller sans alarme, car le pic de cortisol provoqué par le bruit soudain fait oublier instantanément le rêve.
Qu’ils soient fugaces ou vifs, oubliés ou soigneusement enregistrés, les rêves façonnent notre esprit et notre vie éveillée d’une manière que nous commençons à peine à comprendre. Ils nous aident à gérer nos émotions, à explorer de nouvelles idées, à réagir plus efficacement au danger et, peut-être, à entrevoir l’avenir. En y prêtant attention, nous pourrions être en mesure de découvrir davantage notre propre monde onirique.
Ce soir, au moment de nous endormir, posons-nous la question suivante : « Qu’est-ce que notre esprit endormi va nous révéler ? »
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.